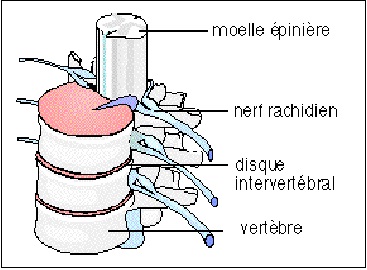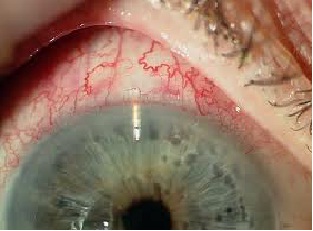Handicaps physiques et mentaux
Handicap physique et sensoriel
Le handicap physique représente l’image même que la plupart d’entre nous
avons d’eux comme avec le fauteuil roulant.
En France, environ 3 enfants sur 1000 souffrent d’handicap physique, motrice sévère.
4% de la population est atteint d’handicap physique. Avec l’âge le taux de
personnes handicapées ne ce cesse de croître.
Ceci peut-être expliqué par l’origine et la nature des déficiences :
- Malformation ou maladie acquise à la naissance
- Accident, traumatisme ou maladie développé durant sa vie
- Maladie évolutive (sclérose en plaque)
Même lorsque la maladie est stable, ses conséquences en termes de
handicap peuvent s'accroître au cours de la vie par des déformations
pendant la croissance ou accrue par le vieillissement.
On distingue plusieurs types de handicaps physiques, selon leurs causes
et leurs conséquences sur l’organisme, le physique et le mental également.
Voici ces différents types :
-Les lésions de la moelle épinière
-Les infirmités motrices cérébrales (IMC)
-Les myopathies
-Les déficiences sensorielles (visuelles et auditives)
Lésion de la moelle épinière
Une lésion de la moelle épinière est un dommage provoquée un niveau
de cette moelle épinière provoquant une diminution de mobilité. Les
nerfs emmenant les signaux vers le cerveau autour de la moelle épinière
sont les neurones moteurs supérieurs. Ceux dits rachidiens qui se ramifient
dans l’organisme sont appelés neurones moteurs inférieurs. Ces nerfs sortent
et entrent au niveau de chaque corps vertébral et sont connectés avec toutes
les régions du corps. Les fibres (dites sensitives) à l’intérieur des
faisceaux ascendants emmènent jusqu’au cerveau des informations sous la
forme sensations comme la douleur, le toucher ou la température. Les fibres
(dites motrices) à l’intérieur des faisceaux descendants envoient des signaux
à partir du cerveau afin de d’ordonner des actions, comme le mouvement. Il y
a 31 paires de nerfs rachidiens, composés des nerfs moteurs et sensitives,
disposés selon les 31 segments de la moelle osseuse.
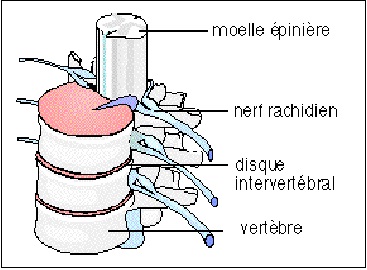
Schéma de la moelle épinière et des vertèbres en vue latérale
Les lésions de la moelle épinière sont le plus souvent causées par des
accidents divers comme en voiture ou véhicule motorisé (50% des cas de
lésions), au travail ou une blessure sportive. Elles touchent principalement
les jeunes de 16 à 30 ans. Elles provoquent souvent une paraplégie
(paralysie des deux membres inférieurs) voire tétraplégie (paralysie
complète) recensées au nombre de 30 000 en France. Le mot tétraplégie
vient du grec « tétra » signifiant « quatre » et « plégia » pour
« paralysie » et provient d’une lésion au niveau cervicale de la moelle
osseuse. Le mot paraplégie vient également du grec « plégia » pour
« paralysie » mais « para » signifie « deux ». La paraplégie provient
d’une ou plusieurs lésions aux régions thoracique, lombaire ou au niveau
des vertèbres sacrées.
La disparition de la motricité s'accompagne chez certains blessés de raideurs
et de contractures douloureuses. On parle alors de « spasticité ». Les autres
ont une paraplégie dite "flasque" qui augmente les risques de complication
due à l'immobilité constante des membres et de la mauvaise circulation
sanguine. Les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière vivent
en moyenne moins longtemps que les personnes non-atteintes. Cependant, leur
durée de vie ne cesse d’augmenter grâce à la connaissance et au traitement
des causes de mortalité comme l’insuffisance rénale avec l’urologie.
Depuis de nombreuses années, des spécialistes travaillent sur la mise en
place de traitements comme les corticoïdes qui diminuent les dommages et
l’inflammation après la lésion. De nos jours, des tests sont effectués
sur les animaux afin de développer de nouveaux traitements afin d’éviter
l’excès de libération de neurotransmetteurs lors de la lésion de la moelle
osseuse. On développe également des traitements de régénération ou de
greffes de moelle.
Les infirmités motrices cérébrales (IMC)
Une infirmité motrice cérébrale est une infirmité motrice causée
par des lésions survenues durant la période périnatale, c’est-à-dire
autour de la naissance. Ce sont des lésions cérébrales non évolutives
et non héréditaires. Elles sont le plus souvent liées à une hypoxie
périnatale, soit un manque d’oxygène dans le sang et les tissus,
une prématurité, un traumatisme cérébral ou un ictère néonatal.
Elle peut aussi être causé par une tumeur ou une incompatibilité
des rhésus des parents. Les rhésus sont positifs ou négatifs selon
la présence ou non de facteur sur les globules rouges. L’origine
de l’IMC est le plus souvent un accident vasculaire cérébral.
Elle touche 3 enfants sur 5 000 naissances environ.
Un ictère néonatal plus communément appelé « la jaunisse » touchant
beaucoup de nourrissons peut être dans certains cas rares, très dangereuse.
Il est causé par une accumulation de bilirubine, soit des pigments provenant
de la bile et de dérivés de l'hémoglobine dans le sang.
On distingue trois types d’infirmités motrices cérébrales.
Il y a les IMC spastiques, c’est la forme la plus fréquente et elle est
le plus souvent la cause d'une naissance prématurée. La spasticité
signifie une hypertonie musculaire, soit une contraction musculaire
répétée voire des spasmes. La célèbre maladie de Parkinson est et une
hypertonie musculaire par exemple. L’hypertonie musculaire perturbe la
motricité fine de la personne qui peut également avoir des troubles de
la sensibilité proprioceptive relative aux mouvements du corps et
l’équilibre et de la stéréognosie, c’est-à-dire l’incapacité d’une
personne à reconnaître et identifier les caractéristiques d’un objet en
utilisant exclusivement le toucher.
Il y a également la forme hémiplégique. Les personnes atteintes sont
assez autonomes physiquement mais souffrent la plupart du temps de
troubles cognitifs importants. Ces troubles peuvent être dues à une
épilepsie, provoquant un arrêt du fonctionnement normal du cerveau, ou
à des troubles visuels importants, comme le strabisme. L’épilepsie
représente 40% des cas.
La dernière forme est la forme athétosique. Cette forme ne représente
que 20% des infirmités moteurs cérébrales. Elle provoque des mouvements
involontaires provoqués par l’émotion. Les personnes atteintes de cette
forme d’IMC ne sont généralement pas atteintes de troubles de la
mémoire, du jugement, de la compréhension, ou du raisonnement
contrairement aux personnes atteintes de la forme hémiplégique
(troubles cognitifs).
Les atteintes du système nerveux en plein développement provoquent
plus tard des conséquences motrices. Le handicap qui peut provoquer
une tétraplégie est possible à atténuer grâce à de la rééducation
et des activités physiques adaptés. L’orthophonie peut également aider
le patient atteint de la forme athétosique à parler. La kinésithérapie
permet de calmer les raideurs comme dans le cas de la forme spastique.
L’ergothérapie permet d’aider l’enfant atteint d’IMC à augmenter un peu
son autonomie et son indépendance grâce à des activités quotidiennes
ludiques comme s’habiller, manger ou communiquer.
Les myopathies
Une myopathie se traduit par une dégénérescence d’un constituant
du muscle.
Ce sont des maladies neuromusculaires souvent d'origine génétique
et évolutive. La myopathie la plus connue est la myopathie de Duchenne
de Boulogne, touchant exclusivement les garçons. Cette maladie
génétique est causée par une mutation du gène de la dystrophine,
provoquant la synthèse d'une protéine tronquée. Cette myopathies touche
1 enfant sur 3500. Les myopathies provoquent donc des mutations au
niveau des gènes.
Certaines myopathies sont acquises, c’est-à-dire qu’elles s’attaquent
à un muscle auparavant sain. Certaines débutent dans la petite enfance,
d'autres à l'adolescence ou à l'âge adulte.
Les myopathies ne sont par conséquent pas toujours détectables à la
naissance. L’âge de diagnostic s’étend sur une échelle allant de 1 à
30 ans, selon la forme de myopathie concernée.
Les troubles causées par ces myopathies peuvent aller d’une difficulté
à marcher jusqu’à une immobilité presque totale provoquant un besoin
obligatoire de fauteuil roulant. Un manque de mobilité faciale peut
également être observé entraînant des troubles de la parole, des
difficultés à déglutir ou à s’alimenter. Tous ces troubles moteurs
peuvent également être accompagnés par des difficultés respiratoires,
des troubles du rythme cardiaque, voire d’un ralentissement de la
croissance. L’évolution de la myopathie est lente elle peut se
stabiliser momentanément ou définitivement.
La kinésithérapie permet de travailler sur la motricité du patient,
mais également de stimuler le corps et le système nerveux.
Des séances chez l’orthophoniste permettent de travailler la déglutination
ou a mastication. Il est aussi possible de recourir à un traitement
nutritionnel dès le plus jeune âge.
Le handicap moteur peut être partiellement compensé par une série
d'aides techniques.
Les ordinateurs qui obéissent à la voix où peuvent être pilotés par
le regard, les dispositifs domotiques et les fauteuils électriques
permettent à des personnes très lourdement handicapées de vivre
indépendantes, avec une aide à domicile quelques heures par jour.
Une scolarité et une intégration professionnelle ordinaires sont toujours
possibles lorsque le trouble moteur est isolé en particulier. Des
troubles cognitifs sont liés à certains types de handicaps moteurs,
notamment chez les IMC. Une rééducation neuropsychologique adaptée
peut y remédier.
Pour un certain nombre de jeunes handicapés moteurs, très dépendants
dans les gestes quotidiens, suivre une scolarité dans un établissement
adapté est parfois préférable à l'intégration collective ou individuelle
dans des établissements scolaires classiques.
Les déficiences sensorielles
Parmi les déficiences sensorielles, on distingue quatres groupes :
les déficiences visuelles et auditives mais également celles concernant
l’odorat et le toucher. Les deux premières sont les plus observées
dans le monde.
La mal-voyance :
En France, on compte environ 80 000 personnes handicapées visuelles en
France. Selon l’Union européenne des aveugles, « une personne malvoyante
est une personne dont la déficience visuelle entraîne une incapacité dans
l'exécution d'une ou plusieurs des activités suivantes: lecture et
écriture (vision de près), activités de la vie quotidienne (vision
à moyenne distance), communication (vision de près et à moyenne distance
), appréhension de l'espace et déplacements (vision de loin), poursuite
d'une activité exigeant le maintien prolongé de l'attention visuelle. »
Cependant, il y a différentes façon de « mal » voir et les situations et
handicaps provoquant des troubles de la vision sont très variés selon
l’âge ou les pays. En effet, certaines personnes peuvent lire mais
nécessitent une canne pour se déplacer, d’autres ne supportent pas les
lieux très éclairés ou certaines se déplacent assez facilement mais ne
reconnaissent pas les visages. Les causes de déficiences visuelles sont
nombreuses : la cataracte touchant un malvoyant sur deux, la
dégénérescence maculée liée à l’âge, le glaucome, le décollement ou le
trachome qui est une infection oculaire bactérienne et contagieuse. Si
la personne n’est pas traitée, la bactérie attaque la cornée de façon
irréversible menant parfois à la cécité.
Le glaucome est une maladie chronique provoquée par la destruction progressive
des fibres du nerf optique sous l'influence de divers comme l'élévation
anormale de la pression intra-oculaire. incapacité dans l'exécution d'une
ou plusieurs des activités suivantes: lecture et écriture (vision de
près), activités de la vie quotidienne (vision à moyenne distance),
communication (vision de près et à moyenne distance), appréhension de
l'espace et déplacements (vision de loin), poursuite d'une activité
exigeant le maintien prolongé de l'attention visuelle. »
Cependant, il y a différentes façon de « mal » voir et les situations
et handicaps provoquant des troubles de la vision sont très variés
selon l’âge ou les pays. En effet, certaines personnes peuvent lire
mais nécessitent une canne pour se déplacer, d’autres ne supportent
pas les lieux très éclairés ou certaines se déplacent assez facilement
mais ne reconnaissent pas les visages. Les causes de déficiences
visuelles sont nombreuses : la cataracte touchant un malvoyant sur
deux, la dégénérescence maculée liée à l’âge, le glaucome, le
décollement ou le trachome qui est une infection oculaire bactérienne
et contagieuse. Si la personne n’est pas traitée, la bactérie attaque
la cornée de façon irréversible menant parfois à la cécité.
Le glaucome est une maladie chronique provoquée par la destruction
progressive des fibres du nerf optique sous l'influence de divers
comme l'élévation anormale de la pression intra-oculaire.
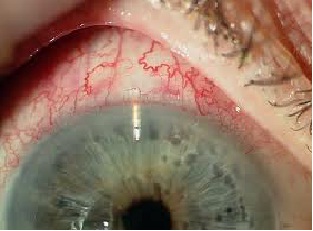
Photo d'un oeil atteint de glaucome
Les autres natures de la mal-voyance et la cécité sont :
- Cancer (rétinoblastome)
- Kératocône (Déformation progressive de la cornée en forme de cône,
liée à un amincissement de celle-ci)
- Atrophie du nerf optique
- Sclérose en plaques
- Maladies métaboliques et dégénératives
- Névrite optique rétrobulbaire (intoxications, alcoolisme...)
- Occlusion (fermeture) des vaisseaux de la rétine
Une personne peut donc devenir malvoyante ou naitre malvoyante à
cause d’une malformation ou une mutation. On peut devenir malvoyant
également à cause d’un accident du travail ou de voiture mais également
avec l’âge comme la cataracte.
Une éducation précoce peut procurer à des jeunes aveugles une grande
autonomie dans la vie sociale. La malvoyance, surtout lorsqu'elle
apparaît à l'adolescence ou à l'âge adulte, provoque souvent un handicap
plus difficile à compenser.
En France, une personne est considérée comme aveugle si elle a une
acuité visuelle de loin du meilleur œil après correction, inférieure
à l/20e ou si son champ visuel est inférieur à 10° pour chaque œil.
Dans les mêmes conditions, une personne est considérée comme
malvoyante si son acuité visuelle de loin est comprise entre 4/10e
et l/20e, ou si son champ visuel est compris entre 10° et 20° pour
chaque œil. Le port de la canne blanche n'est autorisé en France, que
pour une acuité inférieure à l/10e.
Le nombre de malvoyants ne cesse d’augmenter tandis que le nombre de
personnes atteintes de cécité diminue grâce aux progrès thérapeutiques
mais dans le même temps, ceux-ci concourent à l'augmentation du nombre
de malvoyants.
Au-delà des corrections dues au vieillissement, environ 10 % de la
population connaît des difficultés visuelles à des degrés divers.
Sur 750 000 naissances chaque année, environ 100 000 ont ou auront
un problème de vision. Les aveugles représentent 1 Français sur 1 000.
On estime à environ 77 000 le nombre des aveugles en France répartis
comme suit : 20 000 enfants et adolescents et 57 000 adultes. Plus
de la moitié des aveugles ne peuvent trouver du travail du fait de
leur handicap et rares sont les entreprises recrutant des personnes
atteints de cécité. La plupart du temps, ils sont engagés dans des
métiers nécessitant les autres sens comme kinésithérapeute, commercial
ou musicien.
Déficiences auditives
La surdité affecte l’audition des personnes atteintes, rendant ainsi
la communication difficile voire impossible. En France la surdité
concerne plusieurs millions de personnes atteintes à des degrés
divers. Les déficiences auditives ne sont pas visibles. On distingue
plusieurs grands types de déficience auditive.
Le premier est le vieillissement : en effet, à parti de 30 ans,
notre ouïe s’affaiblit progressivement. Parmi les personnes de plus
de 60 ans, 80% sont atteintes de problèmes auditifs provoquant une
audition insuffisante mais seulement 20% possède des appareils auditifs.
Cette surdité est le cas le plus fréquent.
Le second est le bruit trop fort et les excès de décibels causés par
l’utilisation de la télévision ou de baladeurs MP3. Les nuisances urbaines
causées par les transports provoquent également une perte de l’audition.
Le danger de ce type de perte est qu’on ne pense pas en être victime car
on a l’impression que notre oreille s’accommode mais en réalité non.
Un autre facteur de perte auditive est l’hérédité. En effet, un nouveau-né
sur 1000 est atteint de surdité sévère. 80% des surdités sont d’origine
génétique. Cela provoque de forts problèmes d’acquisition langage et
de scolarité chez l’enfant.
Les déficiences auditives peuvent également avoir une cause médicale,
c’est-à-dire une maladie contractée par la mère durant la grossesse,
des otites répétées ou une méningite. Chez une personne plus âgées,
cela peut-être due au tabac, à certains antibiotiques ou au neurinome,
une tumeur non-cancéreuse du nerf auditif.
La dernière cause de trouble auditif l'acouphène. Elle est provoquée
par une transmission anormale du message nerveux vers le cerveau.
Les bourdonnements dans les oreilles apparaissent sans stimulation
sonore externe. C'est tout le système auditif qui est touché.
En fonction de la localisation de l'altération à l'origine de la
surdité, on distingue différentes déficiences auditives : transmission
et perception
Les surdités de transmission affectent l’oreille externe et
l’oreille moyenne.